
Justice et inégalités au prisme des sciences sociales
L'équipe JUSTINES publie ce rapport pour la Mission de Recherche Droit et Justice, qui l'a soutenue financièrement entre 2018 et 2020.
Ce rapport contribue à l’analyse de la contribution des professionnel·les du droit et des institutions juridictionnelles aux inégalités sociales qui structurent les sociétés contemporaines. Il appréhende cette question à partir d’une double enquête, statistique et ethnographique, portant les séparations conjugales, qui constituent un contentieux civil, de masse, touchant l’ensemble des catégories sociales et prononçant des décisions de nature diverse afin d’organiser la vie intime des individus (résidence des enfants, pension alimentaire, prestation compensatoire, etc.). Elles constituent un bon observatoire pour étudier l’effet des inégalités de ressources sociales entre les justiciables sur leurs recours au droit et aux procédures judiciaires, et pour analyser en retour la manière dont l’action des professionnel·les du droit et les décisions de justice sont susceptibles de réduire, de reproduire ou d’intensifier ces inégalités. Pour son volet statistique, l’étude s’appuie sur la construction et l’analyse d’un échantillon représentatif de 4 000 dossiers judiciaires de divorces et séparations conjugales dont la dernière décision a été rendue en 2013 dans 7 tribunaux de grande instance (devenus tribunaux judiciaires) et des 2 cours d’appel, situés dans des territoires aux caractéristiques sociodémographiques contrastées. L’enquête ethnographique s’inscrit dans une recherche au long cours : débutée au sein de tribunaux de grande instance, celle-ci s’est progressivement élargie aux avocat·es et des notaires, mais aussi à deux cours d’appel et finalement à des services publics et associatifs d’accès aux droits. Elle associe de nombreuses observations des situations d’interactions entre professionnel·les et client·es ou justiciables, et des entretiens menés auprès de ces professionnel·les. Cette analyse met en avant la prégnance des inégalités de classe et de genre à toutes les étapes du traitement juridique et judiciaire des séparations conjugales. Il montre que celle-ci s’articule aux inégalités liées au statut matrimonial et au territoire. Selon que les couples ont été mariés ou non, selon qu’ils résident dans l’Ouest de la France ou en région parisienne (et au sein de celle-ci, à Paris ou en banlieue), les expériences de la justice et son impact sur les conditions de vie post-rupture diffèrent notablement.
http://www.gip-recherche-justice.fr/publication/justice-et-inegalites-au-prisme-des-sciences-sociales/
Vie privée : quand l’État rame, les femmes et les enfants écopent
Article publié par trois membres de l'équipe dans la revue Délibérée, n°12, 2021, p. 6-12.
Extrait : " Les contradictions de l’État en matière de vie privée appellent une discussion collective sur les priorités de cette action publique, si cruciale dans une société tendanciellement plus inégalitaire et dans laquelle les droits individuels sont aussi indispensables qu’insuffisants pour garantir la justice sociale. À notre sens, c’est contre les inégalités économiques, les violences de genre et les assignations statutaires qu’elle devrait prioritairement s’atteler à lutter."
https://www.cairn.info/revue-deliberee-2021-1-page-6.htm
La classe, le genre, le territoire : les inégalités procédurales dans la justice familiale
Cinq membres de l'équipe JustineS publient un article dans la revue Droit et Société (2020, n°109, p. 547-566) qui constitue la première exploitation de la base de données judiciaires constituée par l'équipe depuis 2015.
Résumé de l'article : Au moins un couple sur deux se sépare et le traitement judiciaire de ces séparations ne cesse de se diversifier. Analyser les inégalités face à ces procédures est essentiel pour questionner tant l’égalité de traitement dans les services publics que la différenciation des trajectoires sociales à l’issue de ces transitions familiales. Cet article mobilise une base inédite de 4 000 dossiers judiciaires en matière familiale, constituée dans sept tribunaux de grande instance, pour examiner les interdépendances entre les inégalités de classe, de genre et de territoire, au regard des délais de jugement, de la représentation par avocat·e et du recours à l’expertise. Les expériences de la justice familiale des hommes et des femmes qui se séparent sur le territoire français métropolitain varient significativement, tant en fonction de leurs propriétés sociales que de l’organisation des différents tribunaux et des marchés locaux du conseil juridique.
https://www.cairn.info/revue-droit-et-societe-2020-3-page-547.htm?contenu=resume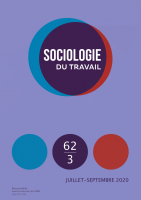
Les avocates en droit de la famille et leurs clients. Variations sociales dans la normalisation de la vie privée.
Céline Bessière, Muriel Mille et Gabrielle Schütz, « Les avocates en droit de la famille et leurs clients. Variations sociales dans la normalisation de la vie privée », Sociologie du travail, Septembre 2020, vol. 62, n° 3 https://doi-org.inshs.bib.cnrs.fr/10.4000/sdt.33401
Dans leur ouvrage de référence paru en 1995, Divorce Lawyers and Their Clients, Austin Sarat et William Felstiner ont mis l’accent sur le travail de normalisation juridique réalisé par les avocats en droit de la famille sur la vie privée de leur clientèle. Cet article enrichit cette analyse aveugle au genre et à la classe, à partir d’une enquête collective menée dans une cinquantaine de cabinets de conseil en droit de la famille, dans la région parisienne et l’ouest de la France, entre 2013 et 2016. En fonction de leurs propriétés sociales, les clientes et clients n’ont pas affaire aux mêmes cabinets, ni aux mêmes avocates et avocats, et y reçoivent un conseil plus ou moins approfondi et personnalisé, différencié selon les problèmes juridiques rencontrés. La normalisation juridique est le résultat d’une coproduction entre ces professions libérales du droit et leur clientèle, qui dépend de la confiance qui s’établit entre elles, mais aussi de la capacité de négociation ou de résistance de la clientèle face à son conseil. Dans ce processus, les avocates et avocats sont confrontés à un entrelacs de questions juridiques et morales. Nous montrons ainsi que la normalisation juridique s’accompagne souvent d’une normalisation morale et qu’elle prend des formes très différentes selon la proximité ou la distance sociale entre les avocat·es et leurs client·es. Cette proximité ou distance sociale est appréhendée principalement à l’intersection de rapports sociaux de classe, de genre et d’âge.
Lien vers l'article
Une clientèle envahissante ? Les temporalités des avocat·es en droit de la famille
Marion Flécher, Muriel Mille, Hélène Oehmichen et Gabrielle Schütz, « Une clientèle envahissante ? Les temporalités des avocat·es en droit de la famille », La nouvelle revue du travail [En ligne], 17 | 2020, mis en ligne le 01 novembre 2020
À partir d’une enquête collective menée dans les cabinets de plusieurs juridictions, cet article étudie le rapport au temps et au travail d’avocat·es en droit de la famille. Nuançant les travaux montrant des avocat·es qui maîtrisent l’interaction avec les client·es, il analyse comment des professionnel·les peuvent se sentir envahi·es. Les avocat·es déclarent d’autant plus être débordé·es que la norme de disponibilité permanente reste très ancrée, même si elle est mise à mal par la féminisation de la profession. La gestion de leur relation avec la clientèle correspond ainsi à différentes logiques d’articulation des temps sociaux, à l’intersection des rapports de genre, des configurations familiales dans lesquels ils et elles sont pris et de leur position dans la carrière. Enfin selon leur place dans le marché du conseil, la composition de leur clientèle ou la taille de leur cabinet, les avocat·es n’ont pas les mêmes ressources pour face à cet envahissement. Les inégalités de genre, de situation professionnelle et de territoire sont alors déterminantes. Cet article prend place dans un numéro de la revue "Travailler dans le droit" coordonné par Gaëtan Flocco et Laurent Willemez
Lien vers l'article
Penser la famille aux temps du COVID-19
Quatre membres de l'équipe JustineS, publient, avec Pascal Marichalar, une analyse de la gestion de crise à l'aune de la sociologie de la famille.
"Penser la famille aux temps du COVID-19", Mouvements, 8 juin 2020. La famille est « le plus familier des objets » selon l’expression du sociologue Rémi Lenoir. Elle apparaît sous l’évidence du déjà-là, du naturel et de l’universel. Nous défendons l’idée que pour mieux comprendre et combattre une pandémie, il est nécessaire d’interroger ce sens commun à partir des recherches en sciences sociales. Car, comme ces dernières le montrent, la famille est une construction historique, sociale, administrative, juridique, économique, religieuse, politique et scientifique. Dans la lignée de nos travaux précédents, notre analyse réinscrit les relations familiales dans les rapports sociaux de classe, de genre, de race, de génération, de sexualité et de dépendance qui les traversent et qu’elles façonnent en retour. La première partie de cette analyse s’applique à déconstruire le sens commun de la famille dans l’expertise et les politiques publiques – en premier lieu la notion de ménage moyen. Le décalage entre ces idées reçues et les réalités familiales a des effets concrets sur les préconisations des épidémiologistes, l’interprétation de leurs résultats et leurs appropriations par les pouvoirs publics. Après avoir ainsi examiné ce que la famille fait à la crise, la deuxième partie éclaire ce que la crise sanitaire fait aux familles. Elle donne à voir les facettes des relations familiales que la crise sanitaire met en jeu, et dont il conviendrait de poursuivre l’exploration scientifique."

Le genre du capital. Comment la famille reproduit les inégalités.
Parution du livre, Le genre du capital, Comment la famille reproduit les inégalités, aux éditions La Découverte. Rencontres dans les librairies : Paris, Le Monte en l'air, le 12 février Dijon, Café-restau La Comédie, le 6 avril Toulouse, Ombres Blanches, le 24 avril Bordeaux, La Machine à Lire, le 7 mai
On sait que le capitalisme au XXIe siècle est synonyme d’inégalités grandissantes entre les classes sociales. Ce que l’on sait moins, c’est que l’inégalité de richesse entre les hommes et les femmes augmente aussi, malgré des droits formellement égaux et la croyance selon laquelle, en accédant au marché du travail, les femmes auraient gagné leur autonomie. Pour comprendre pourquoi, il faut regarder ce qui se passe dans les familles, qui accumulent et transmettent le capital économique afin de consolider leur position sociale d’une génération à la suivante. Conjointes et conjoints, frères et sœurs, pères et mères n’occupent pas les mêmes positions dans les stratégies familiales de reproduction, et n’en tirent pas les mêmes bénéfices. Fruit de vingt ans de recherches, ce livre montre que le capital a un genre. Céline Bessière et Sibylle Gollac enquêtent sur les calculs, les partages et les conflits qui ont lieu au moment des séparations conjugales et des héritages, avec le concours des professions du droit. Des mères isolées du mouvement des Gilets jaunes au divorce de Jeff et MacKenzie Bezos, des transmissions de petites entreprises à l’héritage de Johnny Hallyday, les mécanismes de contrôle et de distribution du capital varient selon les classes sociales, mais aboutissent toujours à la dépossession des femmes. Ce livre analyse ainsi comment la société de classes se reproduit grâce à l’appropriation masculine du capital.

Baptiste Virot et le Collectif Onze publient "Au tribunal des couples"... en BD !
Baptiste Virot et Le Collectif Onze, 2020, Au tribunal des couples, Casterman, coll. "Sociorama".
Malika est greffière dans un tribunal. Chaque jour, elle voit défiler des dizaines de couples qui se séparent. Bien souvent ce sont les femmes qui se retrouvent avec la charge des enfants et de bien maigres compensations financières de la part de leur ex-conjoint, sans que le droit ni la justice ne parviennent à bouleverser cet ordre des choses. Mais, face aux conflits sur les horaires de visite des enfants ou les pensions alimentaires, la juge avec qui Malika travaille reste à l'écoute et cherche des solutions. Un jour elle lui annonce qu'elle change de poste. Le juge qui la remplace est bien moins investi… et risque de faire des dégâts. Basé sur l'observation de 300 audiences et la consultation de plus de 400 dossiers de séparation, cet album fait découvrir la scène et les coulisses de la justice aux affaires familiales, à l'heure où une série de réformes - comme la mise en place du divorce par consentement mutuel sans juge - vise à réduire les moyens d'une justice qui concerne le plus grand nombre.
Site de la collection Sociorama
Pourquoi il faut étudier le genre du capital
Céline Bessière et Sibylle Gollac ont contribué au numéro 100 de la revue Mouvements consacré aux gilets jaunes et à l'imbrication des rapports sociaux de classe, de genre et de race.
Céline Bessière et Sibylle Gollac, « Pourquoi il faut étudier le genre du capital », Mouvements n°100, 2019, p. 135-142.

“Legitimation of Gender Welfare Differences. Sociological insight of law in France”
Article by Dace Šulmane, Adviser to the Secretariat of the Council for the Judiciary of Latvia, “Legitimation of Gender Welfare Differences. Sociological insight of law in France” in the bulletin of the Supreme Court of Latvia, dec. 2019, n°19, pp. 118-120. Dace Sulmane a résumé et adapté pour ses collègues de la cours de justice de Lettonie les résultats de l'article de C. Bessière, "Reversed Accounting" publié dans Socio-Economic Review. A lire ici, en letton.

Reversed Accounting: Legal Professionals, Families and the Gender Wealth Gap in France
Céline Bessière, 2019, « Reversed Accounting: Legal Professionals, Families and the Gender Wealth Gap in France », Socio-Economic Review (DOI: 10.1093/ser/mwz036).
This article describes how legal professionals and families contribute to the widening, legitimation and concealment of the gender wealth gap. It is based on ethnographic observation, study of legal files and statistical data on gender wealth inequality in France. Despite formally equal law, family wealth arrangements in moments of estate planning and marital breakdown tend to reproduce gender inequality. The main legal professionals involved are lawyers and notaries. In their interactions with family members, they carry out reversed accounting, a logic of practice in which the result comes first and computation comes after. As families and legal professionals strive to preserve real estate and businesses, or to minimize taxes, they produce inventories, estimations and distributions of assets which disadvantage women, even though shares appear to be formally equal. Female legal professionals, as well as female clients, may endorse this concern, and thus, also unwittingly contribute to the gender wealth gap.

Une convergence divergente. Séparations conjugales et inégalités sociales en France et au Québec
Nouvel article paru dans SociologieS en octobre 2019
La massification des séparations conjugales et son corolaire, la libéralisation du droit au divorce, sont observées dans la plupart des pays d’Europe et d’Amérique du Nord. À partir d’enquêtes collectives menées durant plusieurs années en France et au Québec, cet article analyse la portée de ces changements sur les inégalités de classe et de genre. Dans ces deux contextes, l’action publique visant les séparations conjugales joue un rôle majeur dans le renouvellement contemporain du gouvernement de la vie privée. Toutefois, la France et le Québec sont caractérisés par des régimes partiellement distincts de reproduction institutionnelle des rapports sociaux. Ceci s’explique notamment par le caractère limité des circulations transnationales, débouchant sur une « convergence divergente » entre ces deux juridictions.
Article en ligne