
JUSTINES
Séparations conjugales, litiges avec les bailleurs, conflits du travail, endettement : de nombreux individus sont confrontés au droit et à l’institution judiciaire. Mais quel contraste entre ce traitement judiciaire du tout-venant, tantôt trop lent (tribunaux engorgés) tantôt expéditif (quelques minutes d’audience voire plus d’audience du tout), et les affaires médiatisées qui impliquent des « puissants ». Cet écart entre la justice de masse et celle qui semble réservée à quelques-uns est frappant et justifie ce programme de recherche pluridisciplinaire, qui analyse les différentes formes d’inégalités face à la justice, afin de mieux les connaître et de les combattre.
Pour nous rencontrer
Voir tous les évènementsColloque de clôture du projet de recherche JustineS
Le projet de recherche JUSTINES (Justice et inégalités au prisme des sciences sociales) réunit une équipe pluridisciplinaire constituée de sociologues, juristes, politistes, économistes et géographes, qui exploite des données quantitatives et qualitatives inédites. Prenant pour point de départ un contentieux civil de masse, les affaires familiales, il s’est étendu à de nombreux autres domaines du droit (justice des mineurs, justice des tutelles, traitement des violences conjugales, contentieux locatif) qui, comme les affaires familiales, permettent d’appréhender le passage en justice de femmes et d’hommes de tous milieux sociaux, aux situations économiques et aux trajectoires migratoires très variées. Il visait ainsi à documenter et analyser à grande échelle la variabilité de l’application de la loi et des formes de confrontation à l’institution judiciaire. Ce colloque fait ainsi le bilan des recherches des membres de l'équipe et, au-delà, des travaux récents menés en France et à l'étranger sur les inégalités face à la Justice. Au-delà des enjeux scientifiques de la discussion entre ces différentes recherches, il vise aussi à mettre à disposition des professionnel·les du droit, des associations et des acteurs publics, des données rigoureuses et des outils de réflexion pour la lutte contre les inégalités face à la justice, dans la formation comme dans la pratique.
Dernier séminaire JUSTINES 2021-2022
Nous nous retrouvons toute la journée, autour de deux invitées : Gwénaëlle Mainsant et Maude Pugliese.
"A qui appartient le droit ?" - séminaire JustineS avec Emilia Schijman
Pour sa septième séance de l'année, le séminaire JustineS aura le plaisir d'échanger avec Emilia Schijman, chargée de recherche CNRS au Centre Maurice Halbwachs.
"Faire famille arc-en-ciel en Catalogne, prises et reprises du droit" : séminaire JustineS avec Marta Roca i Escoda
Pour sa sixième séance de l'année, le séminaire JustineS aura le plaisir d'échanger avec Marta Roca i Escoda, du centre en études genre de l'Université de Lausanne.
Hugo Wajnsztok, "Des amendes pour éviter l'audience pénale" et Mallaury Bolanos "Le rapport défensif au droit des hommes accusés de violences sexistes et sexuelles au travail"
Prochaine séance du séminaire JustineS, le 7 mars 2022 à 14h
Des droits vulnérables : handicap, action publique et changement social - Anne Revillard
Lundi 24 janvier 2022 aura lieu la quatrième séance du séminaire JustineS (Justice et inégalités au prisme des sciences sociales). Nous aurons la chance d'accueillir Anne Revillard (Sciences Po, OSC-LIEPP) pour une séance intitulée : « Des droits vulnérables : handicap, action publique et changement social »
Carnet de recherche
Voir tous les carnets de recherchePODCAST : Pensions alimentaires et inégalités économiques
Proposition de loi visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle
RADIO : retour sur la réforme du divorce de 1975
Pensions alimentaires et fiscalité : réponse à une élue
Le genre du capital - Annexe Méthodologique
Crise sanitaire : le droit rattrape la famille
Suivez-nous
Pour nous lire
Voir toutes les publications
Justice et inégalités au prisme des sciences sociales
L'équipe JUSTINES publie ce rapport pour la Mission de Recherche Droit et Justice, qui l'a soutenue financièrement entre 2018 et 2020.
Ce rapport contribue à l’analyse de la contribution des professionnel·les du droit et des institutions juridictionnelles aux inégalités sociales qui structurent les sociétés contemporaines. Il appréhende cette question à partir d’une double enquête, statistique et ethnographique, portant les séparations conjugales, qui constituent un contentieux civil, de masse, touchant l’ensemble des catégories sociales et prononçant des décisions de nature diverse afin d’organiser la vie intime des individus (résidence des enfants, pension alimentaire, prestation compensatoire, etc.). Elles constituent un bon observatoire pour étudier l’effet des inégalités de ressources sociales entre les justiciables sur leurs recours au droit et aux procédures judiciaires, et pour analyser en retour la manière dont l’action des professionnel·les du droit et les décisions de justice sont susceptibles de réduire, de reproduire ou d’intensifier ces inégalités. Pour son volet statistique, l’étude s’appuie sur la construction et l’analyse d’un échantillon représentatif de 4 000 dossiers judiciaires de divorces et séparations conjugales dont la dernière décision a été rendue en 2013 dans 7 tribunaux de grande instance (devenus tribunaux judiciaires) et des 2 cours d’appel, situés dans des territoires aux caractéristiques sociodémographiques contrastées. L’enquête ethnographique s’inscrit dans une recherche au long cours : débutée au sein de tribunaux de grande instance, celle-ci s’est progressivement élargie aux avocat·es et des notaires, mais aussi à deux cours d’appel et finalement à des services publics et associatifs d’accès aux droits. Elle associe de nombreuses observations des situations d’interactions entre professionnel·les et client·es ou justiciables, et des entretiens menés auprès de ces professionnel·les. Cette analyse met en avant la prégnance des inégalités de classe et de genre à toutes les étapes du traitement juridique et judiciaire des séparations conjugales. Il montre que celle-ci s’articule aux inégalités liées au statut matrimonial et au territoire. Selon que les couples ont été mariés ou non, selon qu’ils résident dans l’Ouest de la France ou en région parisienne (et au sein de celle-ci, à Paris ou en banlieue), les expériences de la justice et son impact sur les conditions de vie post-rupture diffèrent notablement.
http://www.gip-recherche-justice.fr/publication/justice-et-inegalites-au-prisme-des-sciences-sociales/
Vie privée : quand l’État rame, les femmes et les enfants écopent
Article publié par trois membres de l'équipe dans la revue Délibérée, n°12, 2021, p. 6-12.
Extrait : " Les contradictions de l’État en matière de vie privée appellent une discussion collective sur les priorités de cette action publique, si cruciale dans une société tendanciellement plus inégalitaire et dans laquelle les droits individuels sont aussi indispensables qu’insuffisants pour garantir la justice sociale. À notre sens, c’est contre les inégalités économiques, les violences de genre et les assignations statutaires qu’elle devrait prioritairement s’atteler à lutter."
https://www.cairn.info/revue-deliberee-2021-1-page-6.htm
Séparations : les mères ne veulent plus mendier leur pension alimentaire
Les travaux de trois membres de l'équipe JustineS éclairent la réforme des pensions alimentaires intervenue le 1er janvier 2021 et analysée dans cet article d'Alternatives Economiques écrit par Gaétane Poissonnier.
Extrait : « L’intermédiation à la française n’émancipe pas les femmes du rapport de force avec l’ex-conjoint, abonde Emilie Biland-Curinier. On continue de faire peser le fardeau et la charge mentale de l’argent sur les mères. » Une analyse que confirment Céline Bessière et Sibylle Gollac, sociologues et autrices du Genre du capital (La découverte, 2020).
https://www.alternatives-economiques.fr/separations-meres-ne-veulent-plus-mendier-pension-alimentaire/00095237
La classe, le genre, le territoire : les inégalités procédurales dans la justice familiale
Cinq membres de l'équipe JustineS publient un article dans la revue Droit et Société (2020, n°109, p. 547-566) qui constitue la première exploitation de la base de données judiciaires constituée par l'équipe depuis 2015.
Résumé de l'article : Au moins un couple sur deux se sépare et le traitement judiciaire de ces séparations ne cesse de se diversifier. Analyser les inégalités face à ces procédures est essentiel pour questionner tant l’égalité de traitement dans les services publics que la différenciation des trajectoires sociales à l’issue de ces transitions familiales. Cet article mobilise une base inédite de 4 000 dossiers judiciaires en matière familiale, constituée dans sept tribunaux de grande instance, pour examiner les interdépendances entre les inégalités de classe, de genre et de territoire, au regard des délais de jugement, de la représentation par avocat·e et du recours à l’expertise. Les expériences de la justice familiale des hommes et des femmes qui se séparent sur le territoire français métropolitain varient significativement, tant en fonction de leurs propriétés sociales que de l’organisation des différents tribunaux et des marchés locaux du conseil juridique.
https://www.cairn.info/revue-droit-et-societe-2020-3-page-547.htm?contenu=resume
Réforme des pensions alimentaires: quelles nouveautés et quelles limites
Céline Bessière et Emilie Biland analysent la réforme des pensions alimentaires intervenue le 1er janvier 2021 dans un article du magazine Challenges signé par Léa Lejeune.
En savoir plus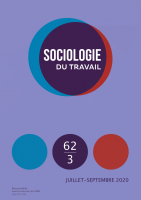
Les avocates en droit de la famille et leurs clients. Variations sociales dans la normalisation de la vie privée.
Céline Bessière, Muriel Mille et Gabrielle Schütz, « Les avocates en droit de la famille et leurs clients. Variations sociales dans la normalisation de la vie privée », Sociologie du travail, Septembre 2020, vol. 62, n° 3 https://doi-org.inshs.bib.cnrs.fr/10.4000/sdt.33401
Dans leur ouvrage de référence paru en 1995, Divorce Lawyers and Their Clients, Austin Sarat et William Felstiner ont mis l’accent sur le travail de normalisation juridique réalisé par les avocats en droit de la famille sur la vie privée de leur clientèle. Cet article enrichit cette analyse aveugle au genre et à la classe, à partir d’une enquête collective menée dans une cinquantaine de cabinets de conseil en droit de la famille, dans la région parisienne et l’ouest de la France, entre 2013 et 2016. En fonction de leurs propriétés sociales, les clientes et clients n’ont pas affaire aux mêmes cabinets, ni aux mêmes avocates et avocats, et y reçoivent un conseil plus ou moins approfondi et personnalisé, différencié selon les problèmes juridiques rencontrés. La normalisation juridique est le résultat d’une coproduction entre ces professions libérales du droit et leur clientèle, qui dépend de la confiance qui s’établit entre elles, mais aussi de la capacité de négociation ou de résistance de la clientèle face à son conseil. Dans ce processus, les avocates et avocats sont confrontés à un entrelacs de questions juridiques et morales. Nous montrons ainsi que la normalisation juridique s’accompagne souvent d’une normalisation morale et qu’elle prend des formes très différentes selon la proximité ou la distance sociale entre les avocat·es et leurs client·es. Cette proximité ou distance sociale est appréhendée principalement à l’intersection de rapports sociaux de classe, de genre et d’âge.
Lien vers l'article













